
La pratique du breton de l'Ancien Régime à nos jours
la-pratique-du-breton.org
La thèse de Fañch Broudic en accès libre

La polémique entre Émile Masson et Yves Le Febvre à propos de la langue bretonne, à la veille de la Première Guerre mondiale
La langue maternelle n’est pas toujours la langue officielle
Lorsqu’il s’engage, à la veille de la première guerre mondiale, dans le militantisme breton et libertaire[1], la première observation que formule Émile Masson[2] apparaît comme une constatation d’ordre général, dont l’énoncé, cependant, ne va pas de soi : « la langue maternelle, écrit-il, n’est pas toujours la langue officielle ». Aussi n’hésite-t-il pas, en vertu de cet axiome, à considérer le français comme « une langue étrangère » en Basse-Bretagne :
À l’inverse, un certain Jopig affirme dans « Le Rappel du Morbihan » que « tout le monde chez nous sait le français ou le comprend, alors que très nombreux sont ceux qui ignorent totalement le breton ». Dans « La Pensée bretonne », Yves Le Febvre circonscrit de même la pratique du breton : il admet, certes, comme
C’est le constat de l’importance de la pratique de la langue bretonne en Basse-Bretagne à ce moment-là qui conduit Émile Masson, alors professeur à Pontivy, collaborateur de diverses revues, en relation avec des écrivains comme Péguy ou André Spire tout comme avec les milieux anarchistes du journal « Les Temps nouveaux », à lancer lui-même une petite revue libertaire, bilingue : « Brug ». Mais si Masson entreprend d’exprimer en breton les idées socialistes et libertaires, c’est qu’il est véritablement impressionné par l’activisme alors déployé par le mouvement breton, aussi bien dans le domaine de la presse et de l’édition que dans celui du théâtre, de l’enseignement du breton, etc.
Utiliser le breton pour se faire comprendre du peuple ?
De fait, les dernières années du XIXe siècle et le début du XXe voient naître diverses initiatives de « résistance linguistique » — l’expression est de F. Elégoet, à propos de « Feiz ha Breiz[3] » — ou « nationale ». À la suite de « Kroaz ar Vretoned », lancé en 1898 par F. Vallée[4] comme supplément breton du journal catholique « La Croix des Côtes-du-Nord », naissent jusqu’en 1914 de nombreuses autres publications, rédigées soit en breton uniquement, soit bilingues. Cette nébuleuse bretonnante, ou bretoniste[5] , est perçue comme catholique et conservatrice. Pour Yves Le Febvre, c’est certain, le mouvement breton dans sa totalité apparaît « en réalité (comme) un mouvement de réaction et de séparatisme ». E. Masson est dans le même état d’esprit lorsqu’il s’adresse à ses camarades : « pensent-ils que tous ces braves gens travaillent pour eux, pour les temps nouveaux ? (…) croient-ils que c’est pour eux que tous ces abbés travaillent ? »
La polémique, pourtant, n’éclatera pas vraiment entre le « Brug » d’Émile Masson et les titres de la presse bretonnante. Celle-ci garde le silence, ou, bien sûr, marque ses réserves, par exemple la revue « Dihunamb » de Loeiz Herrieu[6] qui jugea l’une des brochures de propagande socialiste publiée à l’initiative de Masson « plus dangereuse cependant pour le peuple car elle est rédigée en breton[7] », ou « Breiz Dishual », l’organe du premier Parti nationaliste breton, qui considère les thèses exposées dans « Brug » comme « personnelles à l’auteur » et comme des « théories fort généreuses d’ailleurs, mais dont l’exposé peut heurter certaines de nos convictions exclusives[8] ». E. Masson, pour sa part, s’apprêtait à « malmener un tant soit peu les Bardes et Fédérés » dans le numéro de « Brug » d’août 1914 que la déclaration de guerre empêcha de paraître, mais il s’en était gardé jusqu’alors.
La polémique n’éclata pas non plus vraiment entre E. Masson et ses amis socialistes ou libertaires. Ceux-ci analysaient lucidement leurs handicaps. « Le Militant » faisait par exemple observer dans un éditorial du « Rappel du Morbihan » que
Une fois, dans « Brug », En Neue, pseudonyme de l’instituteur vannetais Julien Dupuis, reproche aux rouges, « républicains et socialistes », d’avoir méprisé « la plupart d’entre eux, la langue et le parler de leur pays », et c’est pourquoi, dit-il, « ils n’ont pas été compris du peuple ». E. Masson lui-même, à l’occasion, regrette que « les révolutionnaires, eux, n’(aient) encore rien tenté, ou si peu, qu’il ne vaut pas la peine d’en parler, pour toucher les populations rurales », plus particulièrement celles qui ont un parler propre.
C’est dans « Le Rappel du Morbihan » que Jopig, déjà cité, demande, à l’inverse, avec vigueur, qu’on ne confonde surtout pas « propagande en Bretagne » et « propagande bretonne » :
Ce point de vue, utilitariste, et qui n’accordait au breton aucune perspective, était aussi celui que développait Yves Le Febvre[12], dans « La Pensée bretonne ». Il avait lancé son périodique en juin 1913, sur la base d’un appel visant à regrouper les intellectuels bretons de conviction républicaine et laïque « pour arracher la pensée bretonne à la réaction cléricale qui l’étreint de toutes parts ». Une centaine de signatures s’associèrent à cet appel, comme Georges Dottin[13], Charles Brunellière[14], Jean Julien Lemordant[15], Camille Vallaux[16], etc., mais c’est Le Febvre surtout qui devait marquer le nouveau titre de ses analyses et de ses convictions.
Yves Le Febvre : l'usage du breton est légitime, mais les Bretons ont intérêt à apprendre le français
Deux affirmations y reviennent comme des leitmotive jusqu’à la guerre : d’une part que « la Bretagne n’est pas que réaction » ; d’autre part que le mouvement breton de l’époque (mouvement littéraire, celtique, bardique ou politique…) n’est vraiment qu’un mouvement de réaction d’inspiration cléricale et que l’objet essentiel du régionalisme est de propager des thèses nationalistes et séparatistes tout à fait condamnables. « La Pensée bretonne » mena une vigoureuse campagne de critique du mouvement breton, en soulignant « tout ce qu’il dissimule de folie et de perfidie ». Elle considérait aussi la littérature bretonnante comme « d’importance secondaire » et de qualité généralement « médiocre », mais elle fut paradoxalement conduite à accorder une grande place à un débat sur la langue bretonne au cours des dix premiers numéros de son existence. On essaiera d’analyser les positions d’Y. Le Febvre dans ce débat.
- Dès le numéro 1, le directeur de « La Pensée bretonne » déclare dans les « propos d’un Breton », chronique régulière qu’il avait déjà tenue dans un précédent journal, qu’il n’est « pas hostile à la langue bretonne, pas plus qu’(…) aux vieilles mœurs et à tous les souvenirs d’un passé dont nous avons le culte autant que quiconque ». Il reprend plusieurs fois cette formulation, notant qu’une telle hostilité serait « peu sage et peu juste ». Son hostilité ne va qu’« aux abus d’une littérature soi-disant d’expression bretonne dont (il) sait toute la médiocrité bruyante ». Pour lui-même, « l’usage du breton est légitime ».
- Toutefois, cette « légitimité » n’est que temporaire. L’usage du breton est certes une réalité, mais la pratique du breton recule devant celle du français. Y. Le Febvre ne «pense pas qu’on puisse en effet retarder la disparition du breton, empêcher son élimination plus ou moins rapide par le français ». Il en conclut qu’il « est tout au moins inutile d’empêcher la pénétration nécessaire du français dans les campagnes bretonnes ». Pour lui, il est évident que « les Bretons ont intérêt à apprendre le français » ; la langue bretonne « ne répond plus aux nécessités historiques, aux besoins profonds de notre race et il est inutile de vouloir la perpétuer pour des raisons de sentiment ou d’art ». De toute façon, l’affaire est pour ainsi dire classée : « un jour viendra, nous l’espérons, où tous les Bretons sauront écrire et parler le français. Ce jour-là la langue bretonne aura vécu ».
- Dans cette perspective, « il n’y a qu’à laisser faire ». Pour autant Y. Le Febvre se déclare « hostile à toutes mesures qui viseraient à proscrire le breton, à en interdire l’usage, à le combattre à la prussienne ou à la russe » et estimerait de telles mesures « injustes et maladroites ». Précisément, l’interdiction du breton dans les écoles et le fait que l’enseignement doive être obligatoirement dispensé en français en Basse-Bretagne ne lui semblent pas être des méthodes « à la prussienne » et ne lui posent donc pas de problème : il reconnaît que « les deux grands ennemis de la langue bretonne » sont, en quelque sorte naturellement, « l’école et le régiment ». Mais il ne conçoit pas que le breton puisse faire l’objet d’un enseignement : le seul enseignement bilingue qu’il approuverait serait français-anglais.
- Y. Le Febvre, pourtant ne voudrait pas être considéré comme un adversaire de la langue bretonne. Il prend soin de préciser à plusieurs reprises qu’il « ne combat pas le breton en tant que breton ». Mais il se veut réaliste, et demande qu’on n’exagère pas l’importance de la littérature bretonnante : « quoi qu’on fasse, elle demeurera toujours sans une bien grande portée artistique ou philosophique ». Il exclut qu’elle se renouvelle « à je ne sais quelles sources sacrées de Cornouailles ou de Galles » et par conséquent « ne saurait devenir vraiment une littérature écrite ». La conclusion est définitive : « vouloir refaire langue bretonne est une pure chimère ».
Ne pas laisser aux seuls réactionnaires le monopole du théâtre breton
- Le breton peut-il, dès lors, présenter encore quelque intérêt ? L’attitude de Le Febvre, « faite de nuances qu’il importe de bien discerner », l’amène à préciser que l’objectif de « La Pensée bretonne » « n’est pas, ne doit pas être une œuvre purement négative ». Ayant bien critiqué « les folies et les chimères » ainsi que « l’idéal équivoque et confus de ces nationalistes ou séparatistes, masqués de régionalisme », il admet que les « paysans qui ne savent que le breton ont droit aux joies intellectuelles qu’ils sont susceptibles d’éprouver et cela dans leur langue même ». Il conçoit donc que « l’on compose des chansons bretonnes et que l’on joue des pièces bretonnes ». En accord sur ce point avec E. Masson, il estime qu’« il ne faut pas laisser aux seuls réactionnaires le monopole du théâtre breton », dont le prototype lui paraît être « Ar gwir treac'h d’ar gaou[17] », une pièce du barde Léon Le Berre — Abalor[18], « ridicule, puérilement composée, puérilement écrite ». Il serait même disposé à accorder son soutien « avec enthousiasme » à « un vrai théâtre breton animé de l’esprit de liberté, de laïcité, de démocratie ». En janvier-février 1914, il va jusqu’à envisager très concrètement la mise sur pied d’un « Théâtre breton républicain », avec le concours du barde Charles Rolland, de Guerlesquin. C’est qu’à propos de breton, la conviction de Le Febvre est qu’« il faut en user simplement pour la propagande ou pour l’amusement populaire ». Il est tout à fait conscient en effet de « l’utilité qu’il peut y avoir d’employer le breton, concurremment avec le français, là où le français n’est pas encore compris. La langue bretonne, maniée simplement et utilitairement, demeure un moyen d’expression très légitime, un moyen de propagande que les républicains auraient évidemment tort de dédaigner ».
Le propos recèle, bien sûr, une contradiction, puisque la simple utilisation du breton ne serait-ce que dans une perspective de « propagande ou d’amusement populaire » n’aurait pour effet que de contribuer un peu plus à son maintien. Le directeur de « La Pensée bretonne » s’avoue d’ailleurs partagé entre la tolérance et l’incompréhension à l’égard de ceux qui œuvrent pour le développement du breton. Il admet d’une part « que ceux qui y ont du temps à perdre s’y amusent, c’est leur droit » ; mais il regrette d’autre part que des « intelligences, si précieuses, si rares, soient nécessairement perdues pour la Démocratie et pour la Bretagne dans la voie où elles se sont engagées ». Ce ne sont pas tant les travaux d’un F. Vallée, « cet innocent bénédictin » qui s’épuise en vaines tentatives « à discuter en breton certaines questions historiques », qui sont ici visés par Le Febvre, que les positions défendues par son propre collaborateur E. Masson.
Émile Masson : la question de la langue bretonne est en Bretagne la plus importante de toutes
Bien qu’il eût, en janvier 1913, lancé son propre bulletin, « Brug », pour répandre les thèses socialistes et libertaires dans la paysannerie de Basse-Bretagne, l’auteur d’« Antée, les Bretons et le socialisme[19] » avait été, six mois plus tard, de ceux qui avaient approuvé l’appel de « La Pensée bretonne », d’ailleurs sous la double signature de son patronyme et de Brenn, l’un de ses pseudonymes. Dès le deuxième numéro du nouveau périodique, il marque ses distances par rapport aux thèses de Le Febvre, et la controverse s’étalera sur cinq mois. En fait, c’est dès 1912 qu’E. Masson avait exprimé ses positions, dans « Antée », puis dans différents articles publiés comme à l’accoutumée sous plusieurs pseudonymes (Brenn, Ionn Prigent, Ewan Gouesnou, par exemple dans « Les Temps nouveaux » ou dans « Le Prolétaire Breton », et bien sûr, dans « Brug ». La philosophie de Masson, dont les premières formulations sont antérieures à la polémique avec Le Febvre, se développe en quatre points :
- puisque le breton est la langue de plus d’un million de personnes en Basse-Bretagne, et celle d’« un bon tiers des Bretons », il ne fait aucun doute que la question linguistique prime toutes les autres : « contre vous, écrit-il à Le Febvre, j’estime que la question de la langue bretonne est en Bretagne, la plus importante de toutes. Car une langue est l’épiderme d’une âme, et pour garder une âme vive, saine et pure, le mieux est de garder vive, saine et pure (sic) son épiderme ! J’estime qu’il est aussi criminel de laisser mourir une langue que de laisser mourir un être humain ».

- la langue bretonne, en soi, ne peut être considérée comme une langue conservatrice ou réactionnaire. On connaît l’exclamation d’« Antée » : « une langue qui soit d’un parti ! une langue qui soit réactionnaire ! » Sur ce thème, Masson réfutait vivement les arguments de ses contradicteurs : « Vous faites de la langue bretonne l’abri de l’obscurantisme et de la réaction. Est-ce la faute d’une langue si elle ne porte que les idées qu’on lui fait porter ? (…) Le paysan breton n’entend parler en sa langue que le pape et le roy. (…) Avec le breton, on peut faire un cantique ou une traduction de l’Internationale : la langue ne sera responsable de rien. Pour moi, elle peut être le porte-voix de mes idées avancées ; pour M. le Recteur de ses idées pieuses (…) »
- de toute façon, ce n’est pas à d’autres qu’aux Bretons eux-mêmes de déterminer l’avenir qu’ils entendent réserver à leur propre langue : « il n’appartient pas à l’étranger, sous quelque prétexte que ce soit, il n’appartient pas à l’étranger à moins d’être un tyran exécrable, hors la loi des consciences, d’imposer sa langue à un peuple loyal en lui interdisant l’usage de la sienne propre, et en le privant ainsi de ses ressources naturelles pour se former un jugement libre et éclairé ».
- enfin, ce n’est pas parce que d’un point de vue strictement linguistique — Masson fait ici allusion à des questions de vocabulaire et d’emprunts — la langue bretonne évolue vers un état de « patois-breton » ou parce qu’elle paraît « appauvrie et abâtardie », comme le soulignent facilement ses adversaires, qu’il faille pour autant la condamner à l’abandon : « le breton parlé aujourd’hui en Basse-Bretagne est un patois franco-breton misérable (…). Pour misérable et moribonde que soit actuellement la langue bretonne, rien n’autorise le désespoir à l’égard d’elle ». E. Masson demandait que l’on cherche à « cultiver » cette langue plutôt qu’à l’extirper.
Dès lors, il prend à partie ses contradicteurs en dépassant la position minimale et utilitariste qu’ils sont disposés à adopter : « ne sauriez-vous concevoir qu’il y ait place à une œuvre sérieuse de propagande bretonne d’éducation populaire s’adressant au plus fort tiers de la population globale du pays ? » Quant à lui, il n’était pas loin d’établir l’équivalence, que refusait Jopig, entre « propagande en Bretagne » et « propagande bretonne », et considérait que la cause de la langue bretonne et celle du socialisme étaient liées : « il faut que le socialisme et la langue bretonne ne fassent en Bretagne qu’un corps et qu’une âme. Leur sort est lié, et celui de la race. Le socialisme ne vaincra que s’il se propage par la langue du pays, et elle aura par lui un avenir plus glorieux qu’elle n’eut jamais ».
« Nous ne demandons rien qu’une chose : que ce peuple soit instruit dans sa langue ! »
Les idées socialistes, explique E. Masson, s’expriment désormais dans toutes les langues du monde. De même que le français s’est répandu au moment de la Révolution de 1789, à travers les nouveaux mouvements, les organisations politiques et par le biais de toutes les mutations qui se produisirent alors, de même Masson annonçait l’intérêt du breton pour la libération du prolétariat en Basse-Bretagne : « La révolution ne détruira que l’iniquité. Elle est le déchaînement des consciences, elle déchaînera les langues enchaînées. Elle sera la levée en masse des rustres de toutes les campagnes du monde enfin parvenues à la maîtrise de leur langue, au libre et noble usage de leur patois (…) Déjà elle travaille dans les syndicats à relever, à agrandir, à embellir les foyers des gueux (…) En tout cas, sache-le bien : toi-même ne seras sauvé de l’iniquité de toutes misères morales et matérielles, et du néant, que si tu sauves ta langue ; que si, en ta langue, par ta langue, avec tes frères des autres nations, tu parviens à la conscience, à réaliser votre volonté de justice sur la terre ». Certes, la vision de Masson est ici optimiste : les Bretons pouvaient sans doute s’exprimer en breton dans les syndicats qu’ils commençaient à créer au début du siècle, mais son souhait de les voir développer ces syndicats et d’exprimer simultanément en breton leur volonté de changement social ne se vérifia pas. Si des syndiqués se sont exprimés en breton, ce ne fut en général que par habitude de parler breton.
La langue bretonne, pour E. Masson, est donc « une conscience ». Étant enseignant, il se devait aussi de protester contre l’interdiction de tout enseignement de la langue bretonne aux jeunes Bretons. Il fut le premier, dans l’enseignement public, à qualifier cette interdiction d’« odieuse absurdité » et de « superbe spécimen » d’iniquité. Un tel parti-pris avait, selon lui, pour conséquence négative d’appauvrir la langue, sans pour autant favoriser un bon apprentissage du français : « sortant de l’école, les petits Bretons n’ont pas appris le français, et ils ont oublié le breton ».
Pire encore, l’interdiction du breton à l’école condamnait la Bretagne et ses habitants à la déchéance, E. Masson développant à ce propos une thèse qui sera reprise par certains psychiatres soixante ans plus tard : « La Bretagne contemporaine est ravagée par l’alcoolisme. Tous ces fléaux ont une origine unique : le défaut d’éducation nationale (…) Quoi d’étonnant à ce que ce pauvre bougre, à qui on arrache la langue, et dont on torture les instincts les plus spontanés, dont on falsifie la mémoire, l’imagination, l’intelligence et la conscience, quoi d’étonnant à ce qu’il se sente méconnu, incompris, ridicule, misérable, exilé, inadapté, désadopté, et cherche dans l’ivresse, la sale ivresse du mastroquet, ou la suave ivresse du prêtre, quelque consolation, quelque oubli, quelque suicide enfin, un refuge quelconque contre les mensonges et les férocités de ce monde ? »
Une langue ne nuit pas à une autre langue
Pour remédier à une telle situation, il propose aux enseignants de faire « de l’enseignement breton-français la base de tout enseignement en Basse-Bretagne (…) Ils leur (aux élèves) enseigneront le breton d’abord, et le français, et une langue internationale (espéranto) (…) Nous ne demandons rien qu’une chose : que ce peuple soit instruit dans sa langue ! » Et il exprime en ces termes la finalité d’un tel enseignement : « J’entends que l’enseignement du breton dans les écoles de Bretagne et par suite (car c’est la même chose) l’enseignement du français par le breton, serve à galvaniser, à retremper l’énergie vitale de notre race ».
En effet, la revendication d’un enseignement du breton, dans l’esprit d’E. Masson, ne s’accompagne pas d’une hostilité à la langue française : « alors que deux langues s’imposent aux jeunes Bretons qui doivent leur être également familières — on les frustre du privilège sacré de s’enrichir de l’une et de l’autre, et on ne leur reconnaît même pas le droit, plus sacré encore, de se servir de leur propre langue maternelle pour apprendre l’autre ! » Il s’en expliquait à Le Febvre : « une langue ne nuit pas à une autre langue. Au contraire, deux langues s’entr'aident, maniées intelligemment ».
Quelques mois plus tard, il s’exprimait avec encore plus de précisions dans sa dernière lettre à « La Pensée bretonne » : « c’est pour l’amour du français même que je suis résolument bilingue. Encore un coup, je le répète je suis pour le breton pour l’amour du français… ou plutôt pour l’amour de l’humanité ». En réalité, Masson ne portait pas plus de considération au français qu’au breton ou qu’à toute autre langue. Dans la mesure où pour lui, une langue telle que le breton était « une conscience », ce qui lui importait c’était qu’il en soit fait un usage réfléchi : « je ne rêve point d’une renaissance linguistique en Bretagne pour l’amour de la langue bretonne (dont je n’ai pas plus le souci que de la française, de l’anglaise, etc. ou… de ma première culotte). Mais je rêve d’une renaissance linguistique en Bretagne pour l’amour et l’énergie vitale de ma race ; et des admirables et pauvres gens qui la composent ».
Si le breton est condamné à terme, ce n’est pas une raison pour le laisser mourir : « Si c’est la destinée de la langue bretonne de périr bientôt, qu’elle périsse donc. Mais nul n’a le droit au secret du destin s’il n’a d’abord, contre l’apparente opposition du destin, lutté jusqu’à la mort pour la raison et pour le cœur humain (…) Nous n’ignorons pas que la cause pour laquelle nous combattons est, selon toutes vraisemblances, perdue d’avance. Mais si elle est, cette cause, notre devoir et notre joie, quel homme, quel Breton surtout, ami ou ennemi, parce qu’elle est perdue d’avance, oserait nous conseiller de la trahir ? »
Entre Masson et Le Febvre : l'impossible convergence
Ce débat sur l’avenir du breton, à la veille de la Première Guerre mondiale, a interféré avec plusieurs autres questions culturelles, philosophiques, économiques, politiques, voire personnelles. Ainsi Le Febvre ne pouvait-il accorder le moindre crédit aux régionalistes, alors que Masson se proposait d’« expliquer et même jusqu’à un certain point (de) justifier les revendications nationalistes — ou même séparatistes ». Le Febvre ayant taxé Masson d’« inconscient suppôt de l’Église et de la réaction », celui-ci n’admit pas que l’on mît en doute ses convictions laïques et républicaines ni d’être « mêlé à une campagne bardique » et il contre-attaqua sur le terrain philosophique en accusant son contradicteur de « transcendantalisme ou idéalisme transcendental ».
Le Febvre avait consenti à publier une « chronique bretonnante » dans « La Pensée bretonne » et en avait confié la rédaction à E. Masson, étant assuré ainsi qu’elle « ne sera(it) quant au fond ni séparatiste ni réactrice ». Mais l’ampleur des divergences entre les deux hommes comme l’intensité de la polémique qui les séparait dans les colonnes mêmes de « La Pensée bretonne » ne pouvaient aboutir qu’à une rupture. Dans le numéro 5 d’octobre 1913, Masson écrit « le dernier mot sur le seuil » et annonce son retrait. Y. Le Febvre n’est pas si mécontent de l’échec de cette expérience « irréalisable », tout en reconnaissant « la valeur morale et le haut idéalisme » de Masson, qui lui-même écrivait à Erwan Berthou à propos de Le Febvre qu’« il a la tête pleine de banalités littéraires et politiques ».
Dans ce débat entre républicains sur l’intérêt de la langue bretonne pour le développement intellectuel de la Bretagne[20], G. Dottin, le doyen de la Faculté des Lettres de Rennes, tenta de calmer les passions en novembre 1913. Il affirmait qu’« il existe une littérature de langue bretonne intéressante et vivante », reconnaissait que cette littérature ne pouvait pas « être à elle seule un instrument de culture », mais qu’elle pouvait « se développer et contribuer à l’expression plus complète des idées et des sentiments propres à un des pays les plus individuels de la terre de France (…) En tout cas, écrivait-il, tant que le breton existe, il peut, à côté du français, servir à faire pénétrer des idées nouvelles », mais aussi, «acquérir de plus en plus, outre sa valeur pratique une valeur d’art originale ».
Mais l’intervention de Dottin, outre qu’elle arrivait trop tard, ne pouvait concilier des propos inconciliables. Y. Le Febvre, tout en approuvant les propos du savant celtisant sur l’utilité du breton, lui reprocha de donner « une base scientifique (…) à ceux qui veulent garder ou refaire la langue bretonne pour conserver la nationalité ».
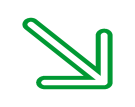
En fait, sa position fondamentale, à propos de la langue bretonne, était de laisser se faire sans intervention l’évolution linguistique fatale commencée et selon lui nécessaire de la Basse-Bretagne, voire de l’accélérer : « nous ne sommes pas responsables d’un tel phénomène qui est conforme à ce que nous pouvons penser du progrès et de la pénétration de la vie provinciale par la vie nationale ». La conviction de Masson était beaucoup plus chaleureuse vis-à-vis du breton : « contre vous je conclus qu’(…) il faut non pas tuer cette langue, mais la cultiver », et s’appuyait sur l’idée que les prolétaires en Bretagne devaient d’abord prendre conscience de leur qualité de prolétaires bretons et s’affirmer en tant que tels : « une langue maternelle témoigne de la vitalité d’un peuple (…). Soyons ensemble tous, des quatre pays d’abord, avec les Gallos ensuite, avec tous les prolétaires des pays de France et du monde.. ».
Il est certain qu’Yves Le Febvre a laissé, dans les organisations bretonnantistes, régionalistes ou nationalistes, le souvenir de déclarations hostiles à la langue bretonne. Il est tout aussi certain que ses prédictions sur la disparition prochaine du breton ne se sont pas vérifiées, justement parce que ceux qui le savent « créent nécessairement l’usage du breton autour d’eux ». Il apparaît bien, enfin, n’avoir jamais adopté d’attitude positive à l’égard de la langue bretonne ne serait-ce que pour « la propagande ou l’amusement populaire », que sous la pression de ses contradicteurs.
Mais en niant toute perspective au breton, Y. Le Febvre prenait une position à la fois réaliste et conformiste, en ce sens qu’elle était conforme à l’idée qu’un grand nombre de Bretons eux-mêmes se faisaient de l’avenir de leur langue.
À l’inverse, celle d’Émile Masson était beaucoup plus volontariste, mais ne s’accordait pas avec l’opinion que se faisaient la plupart des Bretons de leur propre langue. Alors même qu’il se refuse à opposer breton et français, son raisonnement apparaît beaucoup plus conforme à des principes d’équité et de droit. Il n’hésitait pas à s’inscrire dans une perspective de lutte ou de combat en faveur du breton, bien qu’étant conscient du caractère inéluctable des évolutions à venir.
Notes
[1] Ce chapitre reprend, pour une part, des éléments de notre mémoire de maîtrise rédigé en breton sous la direction de Monsieur Yves Le Gallo et publié sous le titre « Al liberterien hag ar brezoneg. Brug : 1913-1914 » aux éditions « Brud Nevez », en 1983. Deuxième édition en 2003, sous le titre «Eun dra bennag a zo da jeñch er bed. Emile Masson ha Brug, 1913-1914», chez le même éditeur. La première partie de présent chapitre a été publiée dans : La Bretagne et les Pays celtiques. Mélanges offerts à Yves le Gallo. Brest : CRBC, 1987, p. 47-56.
Cette première partie utilise par ailleurs les collections de périodiques suivants, dont sont tirées la plupart des citations :
– Brug, 1913-1914
– Le Prolétaire Breton, 1913
– La Pensée bretonne, 1913-1914
– Le Rappel du Morbihan, 1913.
Quelques-unes de ces citations sont également extraites de la réédition des textes d'E. Masson par J.Y. Guiomar, sous le titre : Les Bretons et le socialisme. Maspéro, 1972, 286 p. Les références des autres citations sur lesquelles s'appuient ce chapitre seront mentionnées ultérieurement.
[2] MASSON (Émile), militant socialiste et libertaire (1869-1923). Né à Brest, Émile Masson fut professeur d’anglais au lycée de Pontivy de 1904 à la fin de la guerre. Il était en relation avec des écrivains comme Charles Péguy ou Romain Rolland, avec des militants syndicalistes ou politiques tels que Jean Grave, directeur des « Temps nouveaux », Pierre Monatte, Louis et Gabrielle Bouët. En 1912, il publie un essai sous le titre « Antée, les Bretons et le socialisme ». En 1913-1914, il publie la revue bilingue « Brug ».
[3] Fanch ELEGOET. Prêtres, nobles et paysans du Léon au début du XXe siècle. Notes sur un nationalisme breton. « Feiz ha Breiz ». 1900-1914. PLURIEL, n° 18, 1979, p. 39-90.
[4] VALLEE (François), linguiste et écrivain breton (1860-1949). Né à Plounévez-Moedec, il est l’auteur de divers manuels de breton, et surtout d’un « Grand dictionnaire Français-Breton », paru en 1931, qui le fera surnommer « tad ar yez », « le père de la langue ». Son influence a été considérable sur l’école de « Gwalarn ».
Lucien RAOUL. - Geriadur ar skrivagnerien hag ar yezhourien. Brest : Al Liamm, 1992, p. 406-409.
[5] Voir, infra, chapitre 3.6.
[6] HENRIO (Louis), écrivain breton (1879-1953). Né à Caudan, il est l’un des écrivains vannetais les plus connus, sous le nom de Loeiz Herrieu.
[7] Dihunamb, 1912, p. 158.
[8] Breiz Dishual, n° 3, septembre 1912.
[9] Les Temps Nouveaux, n° 21, 21 septembre 1912.
[10] HERVE (Gustave), journaliste français (1871-1944). Né à Brest. Professeur agrégé, il est radié de l’Université en 1901, pour son antimilitarisme. Son journal, « La Guerre sociale », est l’organe des insurrectionnels. En 1914, il se rallie à l’union nationale. En 1927, il crée un parti d’inspiration fasciste. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse…, op. cit., p. 5251.
[11] Mentionné par J. Y. Guiomar, op. cit., p. 77-78.
[12] LE FEBVRE (Yves), écrivain et homme politique breton (1874-1959). Né à Morlaix, il fut juge de paix à Plouescat. Ancien militant socialiste, c’est en juin 1913 qu’il commence la publication de « La Pensée bretonne ». Il a par ailleurs publié des romans, notamment « Clauda Jegou, paysan de l’Arrée », et « La terre des prêtres » : ce dernier livre, critique par rapport à la religion, fera scandale.
[13] Professeur de celtique et doyen de la Faculté des Lettres de Rennes. Il a notamment publié « La langue gauloise, grammaire, textes et glossaire » en 1920.
[14] Militant socialiste nantais. Il prend l’initiative de créer la Fédération socialiste de Bretagne en 1900, par réaction aux divisions parisiennes.
[15] Avait publié en 1905 « La Basse-Bretagne. Étude de géographie humaine ».
[16] Peintre (1898-1968). Né à Saint-Malo, il est connu pour ses tableaux de l’Hôtel de l’Épée à Quimper et le plafond du Théâtre de Rennes : « notre premier, et jusqu’ici notre unique peintre breton », selon Émile Masson. Il sera blessé au cours de la guerre 14-18 et restera aveugle.
[17] « La vérité victorieuse du mensonge. »
[18] LE BERRE (Léon), journaliste et écrivain breton (1874-1926), barde Abalor.
[19] Ewan GWESNOU. Antée. Les Bretons et le socialisme. Guingamp : Toullec et Geffroy, 1911. Réédité dans « Ar Vro », n° 11, décembre 1961, et par J.Y. Guiomar. Les Bretons et le socialisme…, op. cit., p. 195-222.
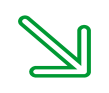
[20] Dans « La Pensée bretonne », plusieurs auteurs ont, aux côtés de Le Febvre, exprimé un point de vue critique par rapport à la langue bretonne. « Une universitaire » juge ainsi que les essais de propagation du breton sont « une fantaisie de lettrés » et l’œuvre de « snobs d’un certain genre », et que le breton ne peut plus que « végéter quelque temps ». Charles Géniaux supposait que « la langue bretonne ne compte pas un seul chef-d’œuvre, que je sache ? » Un certain J. Mariette insistait sur la multitude de dialectes et sous-dialectes du breton. Georges Husson critiquait « les partisans du brezonek universel et obligatoire ». Pour sa part, le sculpteur René Quillivic démissionna de « La Pensée bretonne » en raison des attaques qu’elle lançait contre le breton et contre les bardes. F. Gourvil, alors étudiant, prit la défense du breton en affirmant qu’il fallait « forcer » le public à « s’intéresser à cette littérature qu’il ignore et méprise souvent ».